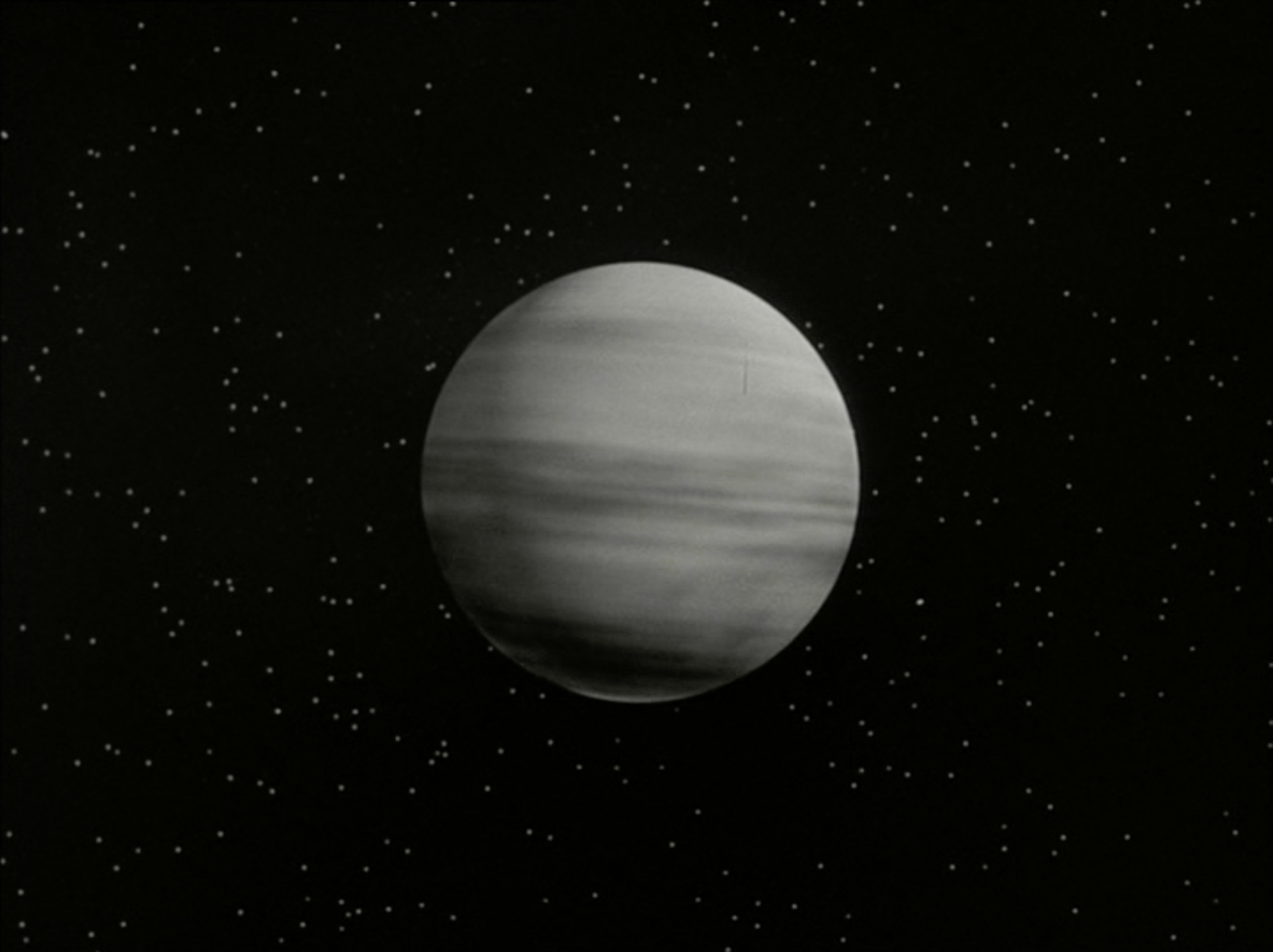(Ce texte a été publié dans le numéro 30 de La Part de l’Œil, Arts plastiques et cinéma ; Mikhaïl Bakhtine et les arts)
…dans l’espoir, me dis-je aujourd’hui, dit Austerlitz, que le temps ne passe pas, ne soit point révolu, que je puisse revenir en arrière et lui courir après, que là-bas tout soit alors comme avant ou plus précisément, que tous les moments existent simultanément, auquel cas rien de ce que raconte l’histoire ne serait vrai, rien de ce qui s’est produit ne s’est encore produit mais au contraire se produit juste à l’instant où nous le pensons, ce qui, d’un autre côté ouvre naturellement sur la perspective désespérante d’une détresse perpétuelle et d’un tourment sans fin.
W. G. Sebald
Amorce
(Souvenons-nous de l’amorce, cette bande de pellicule ajoutée avant le début du film pour en faciliter la manipulation et permettre de l’accrocher au système d’entrainement du projecteur de cinéma. Sans cette part ajoutée pour ne pas être projetée, il n’aurait pas été possible de montrer une première image du film.)
Donc il y aurait un début. Il y en a eu un. Ou il y en aurait eu un parce que cette amorce est déjà passée. On oublie que la couverture a d’abord été regardée, distraitement peut-être, que le titre a été lu, l’éditeur reconnu, que la revue a été saisie, retournée, feuilletée peut-être. Les yeux se sont arrêtés sur certains noms, promettant le plaisir d’une lecture stimulante, certains mots, certaines phrases, quelque chose a retenu l’attention, on suppose, si on est ici, qu’un peu de désir s’est construit dans le flux des idées et des images… et que la lecture déjà entamée se poursuit.
Premier arrivé
Plutôt que moment d’ouverture, ce serait toujours déjà de poursuite qu’il s’agit. Situons : l’histoire du cinéma et le récit de son invention technique confèrent à cette question des débuts une orientation particulière et une curieuse persistance. Le moment de cristallisation – la guerre des brevets qu’entreprit en 1897 Thomas Alva Edison aux Etats-Unis1 – est suffisamment connu pour qu’il impressionne durablement l’imaginaire du cinéma et de son histoire. Certes, l’enjeu de cette bataille juridique était essentiellement économique étant donné que l’institution des brevets accorde un droit d’exclusivité (un monopole d’usage et d’exploitation) au titulaire du titre, en limitant l’usage, par les autres, de l’invention brevetée. Mais l’enjeu est également devenu symbolique vu qu’il confère à l’inventeur, au même titre que le droit d’auteur, la paternité de la création. Il s’agissait également de savoir qui pourrait-être considéré comme le père, ou l’auteur du cinéma, raison vraisemblable du succès de la dissémination de cette histoire.
Or ce système, qui organise et protège les inventeurs par le dépôt de brevets, entérine également la primauté d’une logique purement linéaire du temps. Il s’agit d’une course au premier arrivé, vécue comme telle par ceux qui y participent, et qui continue à se raconter de cette manière aujourd’hui. Seule l’antériorité prime. Malgré la différence entre le système européen et le système américain, c’est la date de dépôt du brevet ou de l’invention qui fait foi. Peu importe qu’un autre inventeur ait « inventé » un objet similaire ailleurs au même moment. Seul compte l’inscription de l’invention dans le registre des brevets. Chaque brevet qui comprend dessins, description et signature d’un témoin, y est identifié par un numéro d’entrée garantissant la succession des dépôts. Pris sous cet angle bricoleur, on le voit, la logique de la succession s’impose de deux manières différentes dans le contexte de l’invention du cinéma. D’une part, elle se manifeste par la mécanique du récit des inventions techniques successives qui ont permis son émergence. D’autre part, elle se marque matériellement dans le registre des brevets qui transcrit la succession de leurs dépôts. Récit de successions et enregistrement matériel évoquent, bien entendu, le cinéma lui-même qui, en ces temps des débuts, n’est autre que l’enregistrement puis la projection d’une succession de vues qui s’enchainent pour donner une image en mouvement. L’United States Patent and Trademark Office doit-il être considéré comme le modèle du cinéma ?
Qu’une telle valeur soit conférée à la succession implacable de la chronologie par des moyens juridiques – et donc avec la possibilité de l’appliquer ou de la contester avec force de loi – aura, dans le réel, des conséquences notablement violentes, particulièrement pour ceux dont l’esprit fantaisiste résiste à se soumettre à l’irrévocabilité de la succession. Ainsi, Georges Méliès, ruiné, perdant son studio et la possibilité d’encore tourner des films, forcé d’abandonner son travail de création, devint marchand de jouets et de bonbons. Selon sa petite fille et biographe, Madeleine Malthête-Méliès, sa faillite trouve son origine dans les déboires de la société de cinéma créée aux Etats-Unis dans le seul but de contourner l’interdiction de diffusion de ses films sur le sol américain, résultant de la guerre des brevets2. Les deux logiques qui s’opposent ici, celle de l’industriel et celle de l’auteur, sont bien connues. Mais leur distinction semble reposer sur deux approches différentes du temps : un temps de la succession et un temps qui ne s’y réduit pas, celui des coexistences.
Succès et succession
Bien qu’il fût journaliste, Georges Sadoul a structuré l’historiographie du cinéma en France et est considéré comme le premier historien du cinéma, ses études se distinguant de l’approche uniquement critique ayant cours avant la première guerre mondiale. L’historien Robert Mandrou lui reconnaît cette qualité en distinguant l’étude historique et la critique de film qui n’est pas historique mais « travaille sur un plan, qu’elle croit historique, en ce sens que ses fichiers des metteurs en scène, acteurs, styles et Ecoles, toujours biographiques, se déroulent dans le temps »3. Si l’ambition affichée de Sadoul, son « objet essentiel est l’histoire d’un art : L’Art du Film »4, (un art et pas une technique), le premier chapitre de son Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours intitulé “L’invention des appareils” dresse néanmoins une chronologie des inventions techniques : Plateau, Marey, Dickson, Edison, Lumières… En procédant ainsi, Sadoul situe l’origine de l’art dont il veut fonder l’histoire du côté de la technique. Certes, juste avant de clôturer ce chapitre et d’entamer ce qu’il dit être son objet essentiel – l’Art du Film – Sadoul s’excuse presque de cette entrée en matière. Mais cette précaution ne vise que la rapidité de son passage en revue de l’invention des appareils5. Ce premier chapitre, “L’invention des appareils”, pose donc une distinction importante : l’histoire de l’art du film n’est pas l’histoire de l’invention des appareils. Distinction à laquelle Godard semble directement répondre dans Histoire(s) du cinéma lorsqu’il affirme du cinéma qu’il n’est ni un art, ni une technique, mais bien un mystère.
Scène primitive
Ce mystère, ne tentons pas de le dissiper trop vite. Restons sur l’amorce, ce court chapitre qui semble si technique et si différent de l’entreprise générale de Sadoul et remarquons que la succession des inventions ne lui permet pas, malgré sa rigueur, d’identifier le moment de naissance faute qu’une de ces nombreuses inventions puisse être considérée comme déterminante. Pour qu’un moment puisse être identifié comme celui de la naissance du cinéma et accessoirement, qu’on puisse en attribuer la paternité aux Frères Lumières, il lui faut le constituer comme tel. Selon Sadoul, cette course à l’invention que se sont disputés, à la fin du XIXe siècle, inventeurs et bricoleurs français, anglais, allemands ou américains, ne pouvait être gagnée que par « celui qui réussirait le premier à donner une série de représentations publiques et payantes »6. S’ensuit un relevé des premières représentations du cinéma disqualifiées parce qu’« isolée », « sans retentissement », « rapidement interrompue par la désertion du public » ou encore se déroulant « avec un succès médiocre ». Ceci exclut de leur donner une valeur historique quelconque, en dépit de leur antériorité. Car « aucun de ces spectacles ne fut accueilli par le succès énorme que remporta le Cinématographe Lumière, à partir du 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines, à Paris »7.
Ce qui justifie de retenir, donc de construire, la projection des frères Lumière comme moment originaire du cinéma – peut-être serait-il plus juste de l’appeler scène primitive du cinéma –, c’est le retentissement mondial dont elle bénéficia, son succès : « toutes les têtes couronnées voulurent voir le nouvel appareil et se firent ses agents de publicités »8. Or, ce succès, n’apparaît qu’à postériori. La valeur d’origine de l’évènement ne lui est conférée que rétrospectivement. Outre que l’origine n’y apparaît plus que comme absente, ceci nous semble avoir deux implications importantes sur ce que l’on appelle cinéma.
La première tient au fait que la logique initiale de la succession, issue de celle des dépôts de brevets, est en quelque sorte interrompue. Ce faisant, les différents développements techniques qui parsèment l’histoire du cinéma (parlant, couleur,…) et modifient sensiblement l’expérience du spectateur, n’ébranleront jamais la certitude que l’on est toujours face à du cinéma9. Le cinéma gagne une permanence par cette opération d’interruption. Ainsi, aujourd’hui, un changement technique aussi important que la disparition du support matériel sur pellicule (qui a également fait disparaître l’amorce qui n’était pas destinée à être vue) au profit d’une diffusion digitale en salles, peut être considéré par un auteur aussi attentif aux conditions de réception de l’expérience cinématographique que Raymond Bellour comme peu signifiant10.
La seconde tient au fait que, ce faisant, Georges Sadoul propose en creux une définition du cinéma : le cinéma est un spectacle, public et payant, d’une projection dans l’obscurité, auquel on assiste collectivement. Comme cette définition repose sur le succès du dispositif, et bien qu’elle ne fasse pas l’objet d’un consensus11, elle s’est néanmoins maintenue jusqu‘à aujourd’hui. Ainsi, la formulation proposée par Raymond Bellour, bien que différant sur deux points, nous semble toujours s’y référer :
« la projection vécue d’un film en salle, dans le noir, le temps prescrit d’une séance plus ou moins collective, est devenue et reste la condition d’une expérience unique de perception et de mémoire, définissant son spectateur et que toute situation autre de vision altère plus ou moins. Et cela seul vaut d’être appelé “cinéma” »12.
Retenons les différences : le temps prescrit et l’expérience de mémoire. Retenons aussi l’importance de la clôture : la salle doit être fermée pour être plongée dans le noir. Il faut y entrer et en sortir. Mais tous ne peuvent y entrer.
E.N.A.
En effet, l’accès à une salle de cinéma, contrairement à celui d’une salle de théâtre ou d’un musée, n’est pas libre. En Belgique, la loi Vandervelde de 1920 interdit l’accès des salles de spectacle cinématographique à tout mineur de moins de 16 ans, sauf exception fixée par la Commission de contrôle des films. Plusieurs projets de modification de cette loi ont été déposés et débattus depuis, mais aucun n’a abouti. Il est intéressant de remarquer que ces nouvelles propositions n’en modifient toutefois pas le fondement. Ainsi celle de 2005 ne fait que renverser la proposition de 1920 en autorisant l’entrée des salles de spectacle cinématographique à tout public, sauf exception fixée par la Commission13. Mais on le voit, l’effet reste identique. En France, la situation est comparable. Depuis 1917, un film doit recevoir et mentionner un numéro d’autorisation pour pouvoir être diffusé : le visa d’exploitation14. Ce visa concerne toute représentation cinématographique. La loi précise ensuite ce qui est visé par ces termes : « constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques ». Dans les deux législations, c’est bien le dispositif de la salle de cinéma qui détermine ce qui est cinématographique. Et c’est ce même lieu que l’on retrouve au cœur de la querelle des dispositifs.
On ne peut que s’interroger sur les raisons qui poussent le législateur à tant de précautions aujourd’hui encore. Sans doute pourrions-nous trouver aisément une explication relative à l’histoire de cette législation, en l’inscrivant d’une part dans l’histoire des dispositifs de contrôles moraux et de censure et d’autre part dans la dangerosité supposée du cinéma qui « avait le pouvoir de changer votre âme ou de vous la dérober ».15 Mais aujourd’hui ? Seul le cinéma se voit encore contrôlé de cette manière. Certes, des indications existent également à la télévision concernant l’âge conseillé des spectateurs. Mais ces mentions sont uniquement indicatives. Elles ne sont assorties d’aucun contrôle policier, d’aucune peine judiciaire. On ne trouve aujourd’hui pareilles dispositions de contrôle, assorties d’un dispositif répressif garantissant son application, que dans le cadre de la protection des mineurs, pour ce qui a trait à l’achat d’alcool, de cigarettes ou pour ce qui touche à l’âge des partenaires dans les relations sexuelles. Remarquons encore que ces trois règlementations concernent également l’image et le désir qu’elle recèle : la publicité y est strictement interdite ou règlementée. Par cet interdit, on tente de limiter l’incitation. L’image est considérée comme dangereuse par son efficacité suggestive, et puisque rien n’empêche un mineur de moins de 12 ans d’acheter le DVD d’un film qu’il ne pourrait aller voir au cinéma, ou de le voir en streaming, le fait de le regarder dans une salle de cinéma est déterminant quant au risque supposé encouru. La salle plongée dans le noir complice du mystère qui s’y déroule, inquiète encore et toujours. Le législateur semble donner raison à Raymond Bellour. Sa définition du cinéma, « une projection publique, en groupe, sur un écran plongé dans le noir » constitue un objet « cinéma » identique à celui qui est visé par les procédures d’autorisation d’exploitation. Voir un film en salle ou le voir ailleurs, semble bien ne pas être la même chose.
D’abord déjà
Ce liminaire, qui introduit un recueil de textes abordant la relation entre le cinéma et les arts plastiques, devrait, comme un générique nous y faire entrer. Mais parfois, lorsque le générique apparait, nous donnant à penser qu’il annonce le début du film et que l’on se prépare à le recevoir, soudain, tout à l’anticipation de cette expérience, on se rend compte qu’il a déjà commencé. Nous mesurons alors notre retard, ce temps de retard, qui nous montre que nous sommes déjà capturés par le film alors que nous pensions nous disposer à le voir.
Quand le film a-t-il commencé ? Comme dans la question de l’origine du cinéma qui se résout par la construction rétrospective d’une scène primitive, le commencement du film… d’un film… est tout sauf évident. Peut-être faudrait-il d’abord s’intéresser à ce qui fait déjà partie du film, comme Jean-Luc Godard disait que, lorsqu’il cherche de l’argent pour faire un film, il réalise déjà son film. Or, et il en sait malheureusement quelque chose, chercher de l’argent ne signifie pas toujours le trouver. Il ne vise pas ici une première étape nécessaire à la suite, comme un peintre achète ses tubes de peintures. Chercher de l’argent, c’est se mettre en situation de devoir parler du film, lui donner une forme langagière, l’adresser à quelqu’un, et la lui adresser en tentant de susciter son désir (de le financer). L’argent n’étant pas toujours trouvé, le film peut ne pas être tourné. Du point de vue de l’auteur, il s’agit peut-être déjà d’un film, mais d’un film sans forme cinématographique et sans spectateur.
Que le cinéaste considère que les conditions nécessaires à la fabrication du film fassent déjà partie du film n’est pas sans effet. Inscrivant ainsi tout film dans le contexte socio-économique de sa possibilité, il indique que l’efficace du film opère déjà si le simple récit projectif de son auteur affecte une seule personne. L’argent espéré en retour étant le signe de cette affection. L’habituelle opposition entre l’industrie de masse (et sa visée financière) et art singulier (désintéressé) se déplace. Dans l’industrie cinématographique la valeur est liée au succès, comme l’est, nous l’avons vu, la définition du cinéma proposée par son premier historien. Poser l’existence du film dès qu’une de ses formes possibles rencontre un spectateur (ici plutôt un auditeur) est une manière de déplacer cette logique sans pour autant vouloir se placer en dehors d’un système économique donné. Mieux, donnant de la valeur à la dépense indépendamment de sa cause (l’investissement qui suppose et espère une plus-value), c’est poser que le projet de film compte par sa capacité à travailler le système économique qu’il parvient à entrainer dans son sillage.
Par ailleurs, cette conception a également quelques effets sur le film lui-même. Il ne peut qu’activer et rendre sensible l’opération d’intégration d’éléments qui lui seraient périphériques16. Nous tenterons d’en montrer une occurrence et d’en dégager certaines implications.
Pas encore
Quand un film commence-t-il pour un spectateur ? Oublions un instant l’appareil critique qui précède le film, la bande annonce, l’affiche, les résumés, les échos de l’accueil en festival, et posons, à titre d’hypothèse simplificatrice, qu’il s’agit de la première image projetée d’un film en pellicule. Supposons que cette matérialité du support cinématographique, bien qu’elle soit à présent en grande partie abandonnée, puisse nous aider à voir, à toucher, donc à penser ce début. Un ruban, à moins d’être refermé sous forme de boucle, a bien un début. Comme la boucle s’épanouit dans les salles d’expositions et pas dans les salles de projection, cette question du début s’inscrit bien dans la problématique soulevée par ce dossier. Quant à la question de l’amorce, nous pourrions l’oublier maintenant en estimant qu’elle est mécaniquement nécessaire à la projection mais ne fait pas plus partie du film (de ce film-ci) que le projecteur lui-même, en ce sens que le projectionniste pouvait utiliser la même amorce pour différents films. Il lui suffisait de la décoller puis de la coller à nouveau.
Intéressons-nous à la première image d’un film déterminé et arrêtons-nous un instant sur son statut. Cette première image fut d’abord une image partagée par plusieurs films. Le nom ou le logo de la société de production, ce qui s’appelait alors la marque de fabrique, est apparue au tout début du XXe tant en ouverture que, parfois, tout au long du métrage, dans le but de lutter (déjà) contre les copies pirates. L’identification des premières productions cinématographiques était une réponse aux vols et aux contretypages des films qui étaient alors monnaies courantes17. C’est dans ce contexte de lutte contre le piratage qu’apparaissent les premières traces d’appropriation. De la propriété à la paternité il n’y avait qu’un pas. L’intention d’identifier chaque film par une carte d’identité qui l’introduirait, prenant rapidement valeur de signature, posa la question de la paternité d’une œuvre résultant de cet art collectif. Qui donc en est l’auteur ? Les inscriptions du générique de début, dont l’ordre d’apparition des noms et la taille de la police de caractère sont réglés par contrat, deviennent un enjeu quant à l’attribution de la responsabilité de chacun dans la fabrication d’un film.
Ainsi, cette première image, ou ces premières images ont-elles un statut essentiellement juridique. L’arrangement contractuel lié aux relations de travail est projeté sur l’écran, se transforme en spectacle. Ce contrat est lié au film, il le rend possible en fixant à l’avance (ou parfois à postériori s’il n’avait pas été respecté) les responsabilités des uns et des autres. Les premières indications du spectacle film sont adressées au spectateur depuis le champ social partagé. Il cadre la fiction, en fixe des règles préalables. Il fait déjà partie du film, du lieu du cinéma (les lumières sont éteintes, le film est déjà projeté) mais pas encore vraiment du spectacle en tant que fiction. La projection des premières images mettent en relation l’ordre social partagé et l’ordre de la fiction.
C’est ce qui rend si intéressante l’entreprise de Godard de faire entrer dans le film ce qui ne devrait que le permettre. « Les films devraient avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre » dit-il dans Éloge de l’amour. Suivons-en les premiers plans.
Reposons-nous la question : quand le film a-t-il commencé ? On se rend compte, à l’intonation de la voix, que le jeu de questions-réponses est issu de l’enregistrement d’un casting. Cette impression se renforcera progressivement puis se confirmera au cours des minutes suivantes du film. On suppose que ce que nous entendons est un enregistrement antérieur au film. Les voix sont off. Jusqu’à la dernière réplique féminine : « quelle époque » qui est synchrone avec l’image de la jeune femme que nous comprenons être une actrice se présentant à un casting. Ce dialogue qui demande d’entrée de jeu de se souvenir des noms (dont le spectateur ignore tout) lors du premier moment (tout aussi mystérieux) constitue une introduction au film, de la même manière que les producteurs, par leurs noms, présentent le film. Puis on se demande si ces premiers mots introduisent, c’est-à-dire évoquent le futur du film que l’on va voir, ou sont, au contraire, tournés vers ce film en tant que déjà passé. Et on se demande si on se souvient encore des noms du début, les noms des producteurs que l’on vient de lire sur l’écran au moment même où la voix masculine interrogeait le souvenir de l’actrice. Alors, les places du spectateur et de l’acteur s’échangeant, l’opposition entre regarder et agir est remise en question. Comme, ici, le moment de cinéma qui précède le film fait déjà vraiment partie du film.
Faire partie
Durant cette première minute, le temps du casting et le temps du générique se superposent. Ces deux temps d’avant le film sont pourtant très différents. Le casting, préalable à la fabrication du film, en est une de ses conditions nécessaires. Il n’est pas montré dans le film. Le générique est un des derniers moments de sa fabrication (comme la préface d’un livre). Il se tient encore sur le bord de la fabrique et déjà, sur le bord du film regardé, en en faisant matériellement partie. Ces deux temps entre lesquels se loge la fabrication du film, Godard les télescope grâce à la puissance du cinéma qui peut associer de force une bande son et des images issues de moments de captation différents, comme le fait également la mémoire. A la succession qui hiérarchise les moments en les excluant les uns des autres, le travail du film oppose la possibilité de la coexistence.
Les deux moments qui coexistent simultanément partagent le même temps. L’un, considéré non-montrable, l’autre au seuil du visible se retrouvent partager la même visibilité, comme l’histoire du temps de l’histoire, que Rancière appelle la nouvelle histoire, prend ensemble petits et grands en étant « le temps où ceux qui n’ont pas le droit d’occuper la même place peuvent occuper la même image »18.
Montrer le casting dans le film consiste également à y faire entrer le réel de l’acteur et de sa situation professionnelle. C’est le champ social du travail, et sa relation au non-travail, qui apparaît dans la fiction. En ce sens, cette pointe de réel est parfaitement à sa place dans le temps du générique. A l’exposition des relations de travail de tout générique de film s’ajoutent ici, comme sa condition de possibilité, le chômage et en corollaire le temps pour penser. Le casting nous apparaît aussi pour ce qu’il est : un entretien d’embauche, semblable à tous les entretiens d’embauche. Le face à face dans lequel transparaît, par le pouvoir du recruteur – ici hors champ –, la violence du monde du travail capitaliste.
Or, le cinéma ne s’est jamais beaucoup intéressé à ces relations. Comme le remarque Rancière, il n’a que peu montré ce qui se disait dans l’usine, comme si les films des frères Lumière avaient fixé pour toujours ce qui est intéressant à voir au cinéma et ce qui ne l’est pas. La sortie des usines Lumières montrait les ouvriers au moment où ils quittaient leur travail. Ni le travail lui-même, ni l’intérieur de l’usine n’étaient montrés. Au point que Rancière se demande si le cinéma peut enregistrer « autre chose que le partage déjà donné du visible et de l’invisible, de l’audible et de l’inaudible, de l’être et du non-être ? »19 Le cinéma peut être autre chose que l’histoire telle que les vainqueurs en proposent l’image, lorsque, comme l’histoire du temps de l’histoire, il « assure son discours […] par la poétique romantique qui opère la constante conversion du signifiant en insignifiant et de l’insignifiant en signifiant »20 Avec l’entretien d’embauche qui intègre le générique du film, c’est d’une pareille conversion qu’il s’agit. C’est une pareille conversion qui agit.
Dans le premier chapitre de Malaise dans la civilisation, pour faire comprendre au lecteur le fonctionnement de la vie de l’esprit et la permanence de la mémoire, Freud, prenant au sérieux le fait que Rome soit dite la Ville éternelle, imagine ce qu’elle serait si rien jamais n’y avait été détruit. Il décrit les anciens bâtiments, les palais, les murs d’enceintes qui continuent à exister matériellement à l’endroit même où de nouveaux sont érigés. L’image est intéressante. Néanmoins il abandonne rapidement cette fantaisie destinée à « nous faire voir combien nous sommes loin de pouvoir saisir au moyen d’images visuelles les caractéristiques de la vie de l’esprit »21 car il estime qu’elle conduit à des représentations qui deviennent absurdes. « Si nous voulons traduire dans l’espace la succession historique, nous ne pouvons le faire qu’en plaçant spatialement les choses côte à côte ; la même unité de lieu ne tolère point deux contenus différents »22. Il était sans doute nécessaire que l’image convoquée par Freud soit impossible. Elle est certes abandonnée, mais uniquement après l’avoir fait exister le temps de sa description. Comme si l’image n’avait été convoquée que pour cela : se maintenir après avoir été délaissée. En nous donnant à percevoir la coexistences de temps successifs, Godard semble reprendre la question posée par l’image freudienne là où il la laissa. Il construit son film comme un espace capable d’accueillir la succession en un même point. C’est alors un espace filmique qui se bâtit, espace dans lequel nous nous mouvons, et qui nous donne à voir et à entendre quelque chose de la vie de l’esprit.
Car il ne s’agit pas seulement pour Godard, dans ce début de film, de condenser deux temps incompossibles. Il s’agit également de placer la mémoire au cœur du sujet du film et de son dispositif de réception. La question posée par la voix masculine évoque un temps antérieur au casting dont l’actrice ne se souvient pas. L’oubli semble pousser l’homme à raconter une histoire comme si elle allait aider à se souvenir. Mais ce qui est raconté ne répond pas à la question posée : « vous souvenez-vous des noms ? » À sa place apparaît l’étoile jaune. L’histoire qui nous est racontée, en étant racontée à l’actrice qui en a oublié les noms, devient une part d’Histoire. Cette Histoire apparaît dans un récit qui s’articule à un autre : celui de la fabrication du film. Histoire et film, tous deux fabriqués par un ordre dont les différents temps seront annoncés un peu plus tard comme étant ceux de l’amour. Ce « quelque chose » nous dit-on, c’est un des quatre moments de l’amour : la rencontre, la passion physique, la séparation et puis les retrouvailles.
Mais n’allons pas si vite. Revenons encore aux premiers photogrammes. Avant le nom des producteurs, il y avait déjà une image, énigmatique : deux statues, une fontaine, la nuit. Cette image ne se raccorde ni aux images suivantes, ni au début de film, contrairement à l’image du livre blanc feuilleté, qui réapparaitra plus loin, accompagnant une question relative à la différence entre le roman et le théâtre. Ce plan nocturne joue un rôle d’image ne prenant pas place dans la suite. Image résistante qui restera longtemps un mystère. Elle est précédée du numéro de visa, lui-même précédé de l’image du logo animé de la société de distribution du film. C’est la distribution qui ouvre le bal directement suivie par la preuve de l’autorisation d’exploitation. Pour pouvoir distribuer, il faut y être autorisé.
Longtemps, les quelques images qui mentionnent l’autorisation, le numéro de visa, étaient collées au début du film. Le film ne pouvait pas être montré incomplet à la Commission de contrôle des films. L’autorisation venant dans un second temps, on ne pouvait qu’ajouter un bout de pellicule avant le film. Quel est le statut de ces quelques images ? Font-elles partie du film qu’elles autorisent à la diffusion en vertu de la loi qui les impose ? Ces images sont nécessairement projetées sur l’écran dans le noir, regardées collectivement. C’est bien le même dispositif cinématographique qui est sollicité. Pourtant elles ne sont pas encore le film. Une partie du film échappe au film.
Rater le début
Nous nous trouvons donc devant une tentative ratée de saisir un commencement, manière de débutant qui bute sur une des différences, la première sans doute, entre un film projeté en salle et un film montré dans un lieu d’exposition. Pourtant, nous ne courons pas qu’en rêve dans les couloirs du cinéma pour ne pas rater le début du film. Mais cette course n’est jamais nécessaire au musée. Le hasard du moment de l’arrivée dans le lieu d’exposition déterminera ce qui sera pour le visiteur la première image perçue du film qui y est projeté. Le film se boucle pour s’adapter aux horaires des visiteurs. Une boucle de pellicule n’a pas besoin d’amorce. Il n’y a plus d’endroit où coller le numéro de visa qui n’est par ailleurs pas requis. La dangerosité disparaît en confiant la première image au hasard. Et lorsque plusieurs projections sont présentes dans le même espace de monstration, c’est encore le hasard et le choix du visiteur qui détermine le moment où, passant d’un film à l’autre, il retient et assemble les images en mouvement en une nouvelle entité, un film virtuel propre à chaque expérience singulière, à chaque fois différente. La projection dans l’espace muséal de films les met ensemble sous le regard, les mets à disposition du regardeur, non seulement dans sa mémoire mais dans l’espace lui même.
L’espace muséal dans lequel sont projetés des films nous apparaît comme la Rome de Freud, à l’image de la mémoire : un espace dans lequel les objets successifs coexistent, uniquement orientés par le corps de celui qui le traverse, institué par cette traversée d’un statut de monteur de temps. Le temps de cette expérience lui confère une plasticité qui révoque l’enchainement des causes et des conséquences conduisant à « l’Histoire comme mode spécifique du temps, manière dont le temps lui-même se fait principe des agencements d’évènements et de leurs signification »23. En permettant la comparaison liée à la coexistence des œuvres et l’ordre aléatoire induit par la présence du spectateur et ses déambulations, le musée apporte au cinéma la possibilité d’inscrire les coexistences au sein de son histoire et de son destin.
1Edison détenait depuis le 31 août 1897 un brevet large sur les prise de vues et la projection des films. Dès décembre ses avocats poursuivirent systématiquement, pour contrefaçon, tous ceux qui utilisaient des appareils équivalents au sien. On estime que cette guerre pris fin en 1908 lorsque Edison, ne pouvant acquérir le brevet sur la boucle de Latham nécessaire à la projection de métrages plus longs, s’associa avec son dernier concurrent pour former la Motion Picture Patents Company. Voir à ce sujet Pierre-André Mangolte, Brevets et émergence de l’industrie cinématographique, une étude comparative États-Unis – Europe (1895-1908), CEPN (IIDE) – CNRS UMR n° 7115 Université Paris-Nord, Décembre 2005.
2 Madeleine Malthête-Méliès, Mélies l’enchanteur, Opéra Mundi, 1973, particulièrement le chapitre XX, “Les premiers signes de la chute”, pp. 315-334.
3Mandrou Robert. Histoire et Cinéma, in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 13e année, n° 1, 1958. pp. 140-149.
4Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial des origines à nos jours, Flammarion, Paris, 1949, 5e édition, 1958, p. 13.
5« Nous avons rapidement passé en revue l’invention des appareils, parce que notre objet essentiel est l’histoire d’un art : l’Art du Film. Étudions maintenant les images animées qui furent les plus lointains ancêtres du cinéma, les premiers balbutiements d’un nouveau langage. » Ibidem.
6Ibid., p. 11.
7Ibid., p. 12.
8Ibidem.
9Comme en témoigne Jacques Aumont dans son questionnement sur le cinéma en tant qu’art moderne : « Or le cinéma, malgré tous ses renouvellements, ses hoquets, ses crises, n’a jamais changé en ceci qu’il s’adresse au nombre ». Jacques Aumont, Moderne ? Comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts, éd. des Cahiers du Cinéma, Paris, 2007, p. 117.
10« Il est clair que l’expérience du spectateur de cinéma est avant tout une épreuve mélangée de mémoire et d’oubli, déterminée par la nécessité de la projection continue propre au dispositif de la salle et de la séance en tant qu’espace psychique et social – cela presque indépendamment du mode de projection (mécanique ou numérique). » Raymond Bellour, La querelle des dispositifs, Cinéma installation, exposition, éd. P.O.L., Paris, 2012, p. 128.
11Voir Raymond Bellour, La querelle des dispositifs, Cinéma installation, exposition, éd. P.O.L., Paris, 2012.
12Ibid. p. 14.
13Loi organisant le contrôle des films et produits dérivés et réglementant l’entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs d’âge, Sénat de Belgique, session de 2004-2005, 8 septembre 2005, Document législatif n° 3-1340/1.
14« La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. » Article L211-1 créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009.
15Jacques Aumont, Moderne ? Comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts, éd. des Cahiers du Cinéma, Paris, 2007, p. 21.
16Est-ce un hasard si la société de production de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville s’appelle Peripheria ? Voir également “On doit tout mettre dans un film” dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Éditions de l’étoile, Cahiers du cinéma, Paris, 1985, p. 295.
17Le contretypage pouvait par ailleurs être parfaitement légal : sur le sol américain, si un film n’était pas enregistré au copyright, il était licite d’en faire autant de copies que l’on voulait, ce qui fut le cas de nombreux films de Méliès par exemple. C’est d’ailleurs grâce à ces copies pirates que la plupart des films de Méliès nous sont parvenus. Celles que possédait le cinéaste ayant été détruites après avoir été vendues au poids afin d’en récupérer les matériaux lors de sa faillite. Voir Sadoul, op cit., p. 58 et Alexandre Tylski, Le générique de cinéma, Histoire et fonctions d’un fragment hybride, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2008, p. 24.
18Jacques Rancière, Figures de l’Histoire, Presse Universitaire de France, Paris, 2012, p. 19.
19Ibid. p. 34.
20Ibid. p. 27.
21Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, édition électronique, collection « Les classiques des sciences sociales » (Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html ) réalisée à partir du livre de Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation. Une publication originalement publiée en français dans la Revue française de psychanalyse, t. VII, n ̊ 4, 1934 et t. XXXIV, n ̊ 1, 1970. Reproduit tel quel par Les Presses universitaires de France, 1971, 108 pages, dans la collection Bibliothèque de psychanalyse. Traduit de l’Allemand par CH. et J. ODIER, p. 9.
22Ibid.
23Jacques Rancière, Figures de l’Histoire, Presse Universitaire de France, Paris, 2012, p. 61.